
Microfibres textiles : une pollution invisible dans notre machine à laver
Par LÉA BAUMRUCKER
(N’hésitez pas à commenter cet article et à poser vos questions en bas de page 🙂 )
Chaque lessive rejette des microfibres dans l’environnement.
Un t-shirt, une chaussette, un pantalon de sport, tous libèrent des fibres en passant dans la machine. Ces fragments de textile, souvent invisibles à l’œil nu, se détachent sous l’effet du frottement, de la chaleur et des détergents.
Qu’elles soient synthétiques (polyester, acrylique) ou naturelles (coton), ces microfibres rejoignent les eaux usées, où elles ne sont que partiellement retenues par les stations d’épuration. Une partie finit dans les cours d’eau, les lacs ou les océans, où elles peuvent persister et interagir avec les écosystèmes.
Selon certaines études, plusieurs centaines de milliers de microfibres peuvent être relâchées à chaque cycle de lavage (Napper & Thompson, 2016).
C’est ce phénomène discret mais préoccupant que j’ai voulu explorer dans mon travail de Bachelor, réalisé dans le cadre de mes études en sciences de l’environnement.
Étudier les fibres dans la machine à laver
Mon objectif était de comparer la quantité de fibres relâchées selon le type de textile lors des lavages domestiques, et d’évaluer si certaines méthodes d’analyse pouvaient permettre de les quantifier.
J’ai donc réalisé plusieurs lavages et récupéré l’eau de rinçage qui a servi d’échantillon pour l’analyse. Ces échantillons d’eau ont été filtrés afin de comparer les différentes matières textiles et leurs assemblages. Les filtres obtenus ont ensuite été observés au microscope et des analyses ont été tentées avec un appareil de mesure appelé spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Le tout avec les moyens à ma disposition en tant qu’étudiante.
L’analyse s’est révélée plus complexe que prévu. Par exemple, le spectromètre détectait aussi du détergent, des traces de peau humaine ou d’autres résidus, rendant difficile l’identification précise des fibres textiles.
Les résultats obtenus au microscope binoculaire étaient néanmoins parlants. Les textiles synthétiques (comme le polyester ou l’acrylique) relâchent davantage de fibres que le coton, ce qui confirme les observations d’autres études. Néanmoins, même les fibres naturelles ne sont pas totalement inoffensives. Elles sont parfois traitées chimiquement, teintées ou mélangées à des fibres synthétiques, ce qui complique leur dégradation.
J’ai également constaté que la quantité de microfibres libérées dépendait de nombreux facteurs, comme l’état d’usure du vêtement, la nature des fibres (vierges ou recyclées), le type de tissage, ainsi que les conditions de lavage (température, durée, type de détergent…). Cela rend toute généralisation difficile et souligne la complexité de cette pollution diffuse. D’où l’importance de développer des protocoles standardisés pour pouvoir comparer les données entre études et mieux comprendre le phénomène.
Enfin, même si l’analyse au microscope est relativement simple et accessible, elle reste limitée. Elle ne permet pas toujours d’identifier précisément les types de fibres, ni de quantifier les concentrations avec exactitude.
Mais pourquoi est-ce important ?
Parce que ces microfibres ne disparaissent pas une fois rejetées. Elles peuvent s’accumuler dans les milieux aquatiques, être ingérées par des organismes, entrer dans la chaîne alimentaire, et transporter avec elles des substances toxiques (colorants, antibactériens, retardateurs de flamme, etc.).
Et surtout, parce que malgré leur omniprésence, ces polluants ne sont pas encore réglementés de manière spécifique. Comme pour les pesticides ou les microplastiques, cette pollution est discrète mais continue. Chaque machine que l’on lance y contribue.
Ce travail m’a permis de mieux comprendre les enjeux liés aux microfibres textiles, mais aussi les limites méthodologiques actuelles. Il met en lumière la nécessité d’investir dans des outils d’analyse fiables et reproductibles, et de sensibiliser tant les consommateurs que les fabricants.
Et maintenant ?
Cette étude m’a donné envie d’aller plus loin, de tester d’autres approches. Mais aussi de transmettre et de sensibiliser parce qu’avant de changer, il faut comprendre.
Une action aussi banale que faire une lessive a des conséquences insoupçonnées.
Et nous avons déjà des leviers à notre portée :
- Choisir des vêtements en matières durables ou peu traitées
- Réduire la fréquence de lavage et privilégier les cycles doux
- Utiliser des filtres à microfibres ou des dispositifs de rétention (par exemple : sacs Guppyfriend), un équipement qui devrait d’ailleurs devenir obligatoire sur les lave-linges neufs vendus en France dans les prochaines années
- Sensibiliser notre entourage à cette problématique émergente
Parce que chaque fibre compte. Et que comprendre ce phénomène, c’est aussi se donner les moyens de le limiter.

Article posté le 5 septembre 2025 par Léa Baumrucker, étudiante en Bachelor à l’Université de Lausanne, Suisse.
>> Pour en savoir plus :








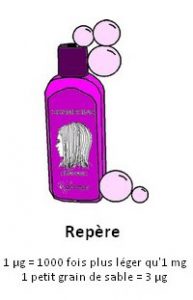 Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an
Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes
Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde
Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne
20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe
La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe 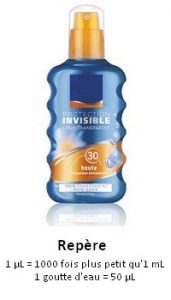 On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent
On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones
En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones 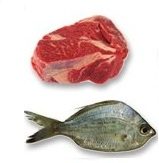 Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne
Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne 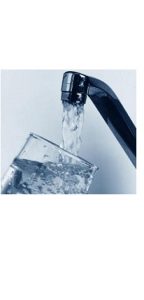 L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées
L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)
Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L) 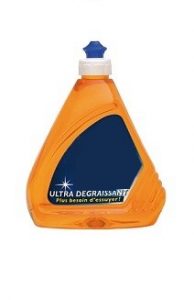 Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%
Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain
Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain 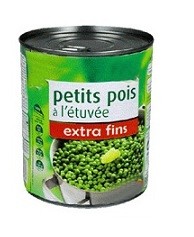 3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006
3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006 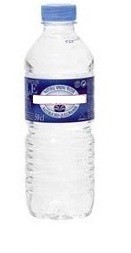 Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
Un commentaire
Ping :