
Anti-puces familial
PAR NATHALIE CHÈVRE
(N’hésitez pas à commenter cet article* et à poser vos questions en bas de page 🙂 )

J’ai toujours eu des chats. J’aime aussi les chiens, mais en ville, c’est plus compliqué car ils ont besoin d’espace.
Lors de notre premier rendez-vous chez le vétérinaire avec notre petite chatte, rentrée du Québec avec nous, celui-ci nous a conseillé de lui appliquer un anti-puces tous les mois. Ayant grandi à la campagne, et ayant toujours vu les chats de ferme se débrouiller sans cela, je n’ai pas donné suite.
Cela a changé avec notre deuxième chatte. Très vite, il s’est avéré qu’elle était allergique aux piqûres de puces. Elle a développé une dermatite et perdait ses poils sur les pattes. Il fallait alors lui faire des piqures d’antibiotiques. Je me suis donc résolue à lui appliquer les pipettes vendues chez les vétérinaires, ce qu’elle détestait pas ailleurs cordialement.
C’est l’arrivée de notre fils qui m’a fait réfléchir un peu plus loin sur ce que je mettais dans notre appartement. En effet, appliqué entre les omoplates, le produit est censé agir sur tout le corps du chat et ceci pendant 1 mois. Or toute personne qui a déjà eu un chat sait que celui-ci se frotte constamment aux meubles et aux coins de portes, voir à nos pieds, pour marquer son territoire. De plus, il ou elle dort souvent sur les lits, dans les armoires ou sur le canapé. Il semble donc assez logique que le produit en question se distribue dans tout l’appartement.
Mais qu’est-ce donc que ce produit miracle contre les puces des chats ? Dans le produit que j’ai acheté, il s’agit d’un insecticide, le fipronil. C’est aussi la même substance préconisée pour les chiens. Bien que neurotoxique, cette substance est surtout active contre les insectes, mais semble moins toxique pour les animaux à sang chaud.
Il reste que c’est un pesticide, qui est aussi utilisé dans l’agriculture, notamment pour la protection des semences. Il a été mis en cause, au côté des néonicotinoïdes, dans la disparition des abeilles.
Le rapport de 2021 de l’OMS sur les résidus de pesticides dans l’alimentation considère que les résidus de fipronil ne posent pas de problèmes pour l’homme et qu’il est peu vraisemblable qu’il soit cancérigène ou génotoxique. En revanche, je n’ai trouvé aucune étude qui évalue le risque si on s’expose via ses animaux domestiques.
Il a cependant fait l’objet d’un scandale sanitaire en Europe en 2017: « les oeufs au fipronil » . En effet, des poules pondeuses avaient été traitées illégalement contre le pou rouge aux Pays-Bas et en Belgique avec du fipronil. Des dizaines de millier d’œufs furent contaminés et ont dû être éliminés. Mais le message des gouvernements, à l’époque, fût plutôt rassurant. Reste que ce produit est passé des plumes de la poule à l’intérieur de l’œuf… ce qui n’est guère rassurant.
Le fipronil n’est pas le seul pesticide utilisé dans les anti-puces. On y trouve aussi de la perméthrine, très toxique pour les insectes et pour les amphibiens. Et même pour les chats comme le rappelle en 2023 l’ANSES.
A part les chiens et les chats, des animaux comme les vaches ou les chevaux peuvent aussi être traités. Le DEET, un répulsif développé pour la guerre du Vietnam, est communément utilisé dans les écuries et les étables. Il repousse les mouches et les taons. On le détecte d’ailleurs dans des concentrations assez élevées dans les cours d’eau suisses. De nouveau, il existe très peu d’études sur sa toxicité et son écotoxicité, ce qui fait que le DEET n’est pas vu comme un problème pour l’instant.
Mais revenons à notre anti-puces. Ayant regardé plus en détail la composition de la pipette en question, je l’ai bannie de notre appartement. Lorsque mon fils était bébé, il passait son temps par terre. Le risque lié à cette exposition continue me semblait déraisonnable. Mais je n’ai aucune étude pour le prouver…
Et notre chatte ? Elle a vécu jusqu’à 17 ans. Après avoir essayé d’autres traitements aux huiles essentielles (peu efficaces dans son cas et peut-être pas tout-à-fait anodins non plus), j’ai testé des méthodes alternatives qui ont marché. Tant mieux.
Reste la question suivante : pourquoi proposer de traiter systématiquement les animaux domestiques avec des anti-puces ? Certes aucune étude n’a montré qu’ils étaient vraiment problématiques, même si des chats et des chiens sont déjà morts après l’application. D’ailleurs en 2016, un article dans Science et Avenir posait la question de la toxicité de ces produits pour les animaux et les enfants.
Ne serait-il donc pas judicieux de garder les anti-puces pour des cas problématiques, par exemple les allergies aux piqûres de puces citées plus haut ? Et de laisser nos animaux se débrouiller dans les autres cas ? Notre exposition aux pesticides en serait certainement allégée.

Article posté le 21 mai 2025 par Nathalie Chèvre, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne, Suisse.
*Pour ceux qui lisaient mon blog dans le journal suisse Le Temps, j’ai décidé de reprendre certains posts en les mettant à jour. En effet, le journal a supprimé les textes en ligne.






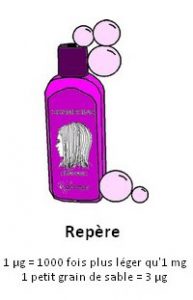 Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an
Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes
Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde
Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne
20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe
La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe 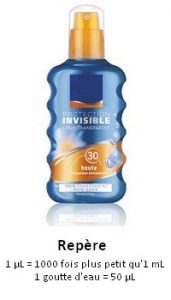 On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent
On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones
En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones 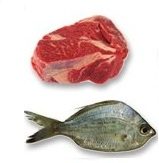 Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne
Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne 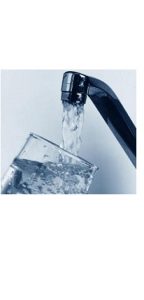 L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées
L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)
Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L) 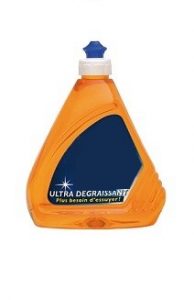 Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%
Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain
Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain 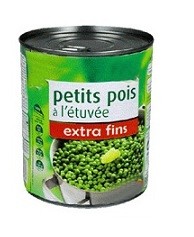 3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006
3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006 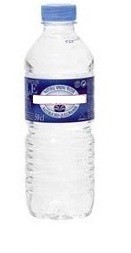 Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
3 commentaires
Yann Tessier
Merci pour cette réflexion Nathalie.
Dans le même registre, ces antipuces/tiques systémiques à base de « laners », des PFAS me semble-t-il… qui pour le coup sont probablement moins toxiques pour l’humain par contact direct, mais d’une autre façon pour l’environnement.
Nous avions décidé d’éviter ces produits pour notre chien. Nous vivons à la campagne et il y a deux semaines, deux tiques gorgées de sang ont échappé à notre vigilance. Nous les avons extraites le plus vite possible (pour éviter l’inoculation de babésia ou autres maladies vesctorielles) mais nous avons pris la décision de refaire avaler à notre chien un comprimé de fluralaner, pour passer la saison des tiques…
Pas facile !
Bernard HINAUT
Bonjour
quand je vivais en ville avec des moquettes au sol, mes chats/chattes avaient apparemment plus de puces que maintenant. Ici, maison à la campagne avec carrelage au sol, il me semble que mes chats/chattes (en moyenne une dizaine) n’ont plus de puces; ils se grattent occasionnellement, ce qui indiquerait plus une libération d’agressivité que de puces… Bon, j’ai trop de chats pour les traiter régilièrement avec des produits qui coûtent très chers; ce n’est pas par manque d’argent, c’est pour ne pas générer une activité inutile, voire malsaine… J’imagine que les puces ont des virus qui maintiennent leur population à un taux acceptable… et puis je nettoie si possible toutes les deux semaines les plaids du grand divan = mon lit + lieu de prédilection des chats et chatons occasionnels
Je retire à la main les tiques des chats qui vadrouillent. Pas de crainte particulière sur ce point
J’ai au moins un chat ou chatte qui meurt tous les ans; c’est dur, mais rien ne peut assurer une sécurité parfaite, surtout en bordure de route, même très peu fréquentée
jim siclon
Bonjour et merci de ce rappel. Je pense que les propriétaires d’animaux domestiques, aiment les animaux en général, mais le paradoxe est que leurs pratiques vont à l’encontre de la biodiversité. Ce sont les discours bienveillants des laboratoires, relayés par les vétérinaires qui rassurent les propriétaires et font l’impasse sur les conséquences écologiques, qui en sont responsables.
Notez que les brebis sont également largement traitées au fipronil…les pluies qui ruissellent sont catastrophiques pour l’environnement.
Cordialement