
Des pesticides peu toxiques, vraiment ?
PAR NATHALIE CHÈVRE
(N’hésitez pas à commenter l’article en bas de page 🙂 )
J’ai reçu plusieurs questions récemment concernant les insecticides. En Suisse, car le Département fédéral de l’environnement (vraiment ?), des transports, de l’énergie et de la communication cherche à éviter de légiférer sur la deltaméthrine. Et en France, où le Sénat a voté en janvier 2025 sur la ré-introduction à titre dérogatoire de l’acétamipride. Un sénateur aurait d’ailleurs déclaré que ce produit n’était que faiblement toxique.

Alors soyons clairs. Les pesticides sont toxiques par définition. Ils ont été développés pour tuer. Heureusement pas tout le monde ! Mais les espèces ciblées, et les espèces qui leur ressemblent, oui. Soit les « ravageurs »: insectes, plantes, champignons, etc.
De manière ciblée ? A tout bien regarder, pas si sûr.
Ce n’était en tout cas pas le cas des premières générations d’insecticides comme les organophosphates. Ils agissent sur le système nerveux des insectes et des vertébrés. Pas étonnant, ce sont des cousins des gaz de combats développés pendant la deuxième guerre mondiale. Une exposition répétée à ces substances est d’ailleurs suspectée de contribuer au développement de la maladie de Parkinson.
Depuis nous avons fait des progrès et les insecticides sont moins toxiques pour les vertébrés. Mais ils sont toujours toxiques pour les espèces ciblées.
Protéger grâce à des seuils de référence
Comme je l’avais expliqué dans mon papier de janvier 2024, nous essayons, depuis les années 1980, de gérer la toxicité du monde qui nous entoure par le risque. En résumé, l’objectif est de protéger la santé humaine et l’environnement, et en parallèle, de « ne pas trop » brider l’économie. Et pour y parvenir, nous avons choisi la méthode des seuils de référence (ou critères de qualité, ou exigences, ou…).
Soyons clairs, les seuils sont basés sur des modèles et surtout, ce sont des consensus. Discutés avec les scientifiques, mais aussi avec les milieux économiques et politiques. Il faut souvent des années de discussion avant qu’une agence accouche d’une valeur qui va être inclue dans les lois.
Ces années de discussion sont certes nécessaires pour faire une bonne évaluation et tenir compte des données disponibles, ou tenir compte du manque de données. Mais c’est aussi le temps que les différents lobbys fassent leur travail.
Quand ces seuils sont dans les lois, ils permettent de prendre des mesures. Par exemple en cas de dépassement, diminuer les quantités utilisées, ou même interdire la substance.
Des seuils bien souvent dépassés
Or depuis quelques années, on se rend compte qu’on trouve ces substances chimiques partout, et que bien souvent, les seuils sont dépassés. De plus, la biodiversité est en chute libre dans les milieux terrestres et dans les eaux.
Que faire ?
Car l’idée est toujours de « ne pas trop » brider l’économie.
On pourrait ne pas fixer de seuil réglementaire. C’est l’idée suisse pour la deltaméthrine. Sans seuil, il n’y a pas de dépassements et donc pas de mesures à prendre… Sauf que dans le cas de cet insecticide, il existe une valeur seuil établie par la communauté scientifique. Qui est très basse car c’est une substance très toxique. Donc malheureusement (ou heureusement) on voit quand même rapidement qu’il y a un risque pour la biodiversité des cours d’eau si elle est détectée dans le milieu.
Ou on pourrait demander une dérogation en prétextant une substance peu toxique. C’est l’idée française pour l’acétamipride. Mais peu toxique pour qui en fait ?
Regardons le rapport de l’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) sur cette substance datant de 2016. L’acétamipride présenterait un risque moyen à élevé pour les oiseaux insectivores. Mais l’agence conseille de vérifier ces résultats car basés sur des modèles (cela a-t-il été fait ?). De plus, l’Agence souligne qu’il manque des données pour l’évaluation à long terme des effets sur les arthropodes et sur les abeilles suivant les voies d’ingestion. Sur la base de ce rapport, difficile de dire que cette substance est faiblement toxique.
D’autre part, l’EFSA a abaissé le seuil acceptable pour les résidus de l’acétamipride dans l’alimentation d’un facteur 4 en mars 2024, en raison d’incertitudes en lien avec le développement de symptômes de neurotoxicité chez l’humain.
Jouer franc jeu
Je ne sais pas vous, mais moi je préfèrerais que l’on joue franc jeu. Notre mode de vie, nos modes de production, nécessitent actuellement l’utilisation d’une multitude de substances chimiques. Mais nous n’avons aucune idée réelle des effets sur le long terme de ces substances, en mélange, sur nous-même et sur notre environnement.
Nous avons donc le choix de continuer ainsi (mais il n’est pas nécessaire de nous faire croire qu’il n’y a aucun risque, nous ne sommes pas dupes) ou de changer de stratégies et de limiter l’utilisation de certaines d’entre elles. Comment ? J’ai suggéré déjà certaines pistes dans d’autres papiers de blog. J’y reviendrai. Mais je pense que vous avez aussi des idées ?

Article posté le 13 février 2025 par Nathalie Chèvre, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne, Suisse.






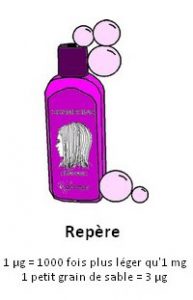 Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an
Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes
Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde
Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne
20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe
La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe 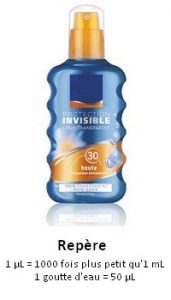 On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent
On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones
En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones 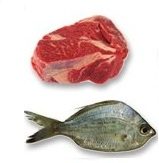 Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne
Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne 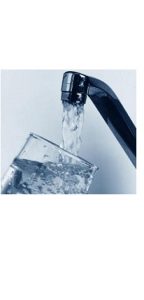 L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées
L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)
Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L) 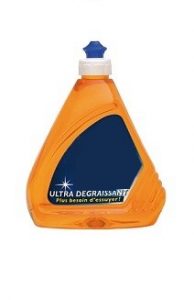 Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%
Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain
Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain 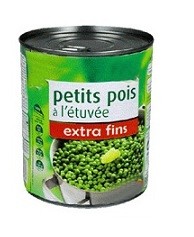 3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006
3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006 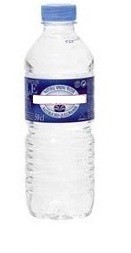 Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
4 commentaires
Leaf_free
L’impact des pesticide n’est plus à prouvé, de nombreux articles scientifiques le démontrent d’ailleur dans la littérature. Un paradoxe est bel et bien en cours de nous autorissons de lus en plus de pestiicide, mais les études indépendantes pour évaluer leurs effets sont de moin en moin finacée ! Ce mode de culture dépendant de la chimie n’a que trop duré, au prix de la vie de nos sols, de la biodiversité, de la santé des écosystèmes et de nos agriculteurs ! Des valeurs seuil d’accord, mais en sachant que ce ci sont élaborée en conditions controlmé en laboratoire , reflète t’il la réalité, et les mélanges de pestcides , l’influence de l’environnement comment rentranscrire tous cela dans des seuil. Une réglement
Yann Tessier
Nous sommes dans un cycle politique terrifiant. Merci Nathalie pour cette analyse, qui nous rend ces fait accessibles.
Thierry Maeder
Bonjour Nathalie, tu parles de valeurs-seuil basées sur des modèles. Serait-il possible d’améliorer ces modèles (simulations numériques?) et d’affiner leurs prédictions afin d’avoir une idée beaucoup plus précise « des effets sur le long terme de ces substances, en mélange, sur nous-même et sur notre environnement »? Meilleures salutations et bonne continuation, Thierry
Nathalie Chèvre
Bonjour Thierry, l’élément limitant est actuellement les données d’écotoxicité à disposition. Pour le moment, la plupart des seuils sont calculés sur la base de ces données et d’un facteur de sécurité (largement subjectif). C’est surtout une méthode qui permet de comparer les substances en terme de risque, mais ces seuils ne sont pas vraiment réalistes. Ils donnent une indication. Utiliser des modèles plus complexes est possible si un nombre suffisant de données d’écotoxicité sont disponibles. Cela permettrait alors de faire des prédictions par exemple pour des groupes de substances et des mélanges. Mais pour une très large gamme de substances, par exemple beaucoup de médicaments ou de cosmétiques, le nombre de données à disposition n’est pas suffisant. Et le vivant se laisse difficilement modéliser, ce qui ne permet pas vraiment non plus de créer ces données artificiellement.