
Des microplastiques dans nos parcelles agricoles – une pollution invisible
Par OCÉANE PFISTER
(N’hésitez pas à commenter cet article et à poser vos questions en bas de page 🙂 )
Devenus omniprésents, les plastiques polluent aujourd’hui chaque recoin de notre planète, des sommets des montagnes jusqu’au fond des océans. Une partie de cette pollution est pourtant rendue invisible par la petite taille des particules. Lorsque celles-ci sont inférieures à 5 mm, on parle de microplastiques. Ces microplastiques, formés par la fragmentation des plastiques ou produits directement à cette taille, polluent tous les compartiments de l’environnement : l’eau, l’air, et même le sol. Les parcelles agricoles sont largement polluées par les microplastiques, impactant la qualité du sol et l’écosystème présent. Ceux-ci pourraient même remonter la chaîne alimentaire et être présents dans notre nourriture ! Mais d’où viennent-ils ? et peut-on y remédier ?

Remonter aux origines des microplastiques
Dans le cadre de mes études au sein de l’Université de Lausanne, j’ai cherché à évaluer les origines de microplastiques présents dans les sols agricoles suisses. Malgré le manque actuel de données et de connaissances sur le sujet, j’ai estimé – à partir de la littérature scientifique – la quantité, forme et composition que pouvaient prendre ces particules dans les parcelles maraîchères et de grandes cultures.
Le mode d’entrée de ces particules diffère selon le type de pratique. La source peut être volontaire, liée à une utilisation consciente du plastique, ou involontaire, quand le plastique n’est ni utile ni souhaité mais tout de même présent. Le microplastique peut être primaire – formé à cette taille-, ou secondaire – issu de la fragmentation de plastique plus gros. A noter que j’identifie ici les intrants associés à l’agriculture, mais que la pollution des sols se fait également via d’autres sources diffuses tel que le dépôt atmosphérique, le littering (abandon de déchets dans l’environnement) et l’abrasion des pneus.
Les utilisations du plastique en agriculture
Les pratiques maraîchères utilisent largement du plastique, afin d’améliorer le rendement des cultures. Les serres et tunnels, ainsi que les films de paillage sont utilisés pour créer un microclimat favorable à la croissance de plantes. Bien que leur usage apporte divers bénéfices – limitation du besoin en eau, réduction de l’usage d’herbicides, protection des intempéries –, il conduit à la formation et à la présence de microplastiques dans les sols. Face à l’exposition au rayonnement UV, à la chaleur, et en présence d’oxygène, le plastique subit une dégradation abiotique qui conduit à la formation de particules plus petites. La manipulation des films et les intempéries favorisent également ce processus de fragmentation. Le système d’irrigation goutte-à-goutte participe aussi dans une moindre mesure à cette pollution.
Les films de paillage sont particulièrement problématiques, en raison de leur manipulation plus fréquente et de leur finesse, qui les rendent plus propices à la fragmentation. En Suisse, ils apportent environ 2 kg de plastique par hectare chaque année. Une large proportion de ces intrants pourrait pourtant être facilement évitée si les fabricants de film étaient plus transparents à leur sujet. En effet, de nombreux films dits trompeusement « biodégradables », en raison de produits accélérant leur fragmentation, sont vendus et laissés dans les sols à la fin des cultures. Ils apportent alors d’autant plus de microplastiques. Il est donc essentiel que seuls des films certifiés biodégradables – et dans des conditions réelles -, puissent être laissés dans les sols.
Du plastique dans les engrais et les semences
Le maraîchage et les grandes cultures utilisent des amendements organiques pour fertiliser les sols. Ces amendements sont souvent largement pollués par du plastique, et apportent alors de manière involontaire et souvent inconnue des microparticules. L’engrais à base de boue d’épuration, interdit en Suisse depuis 2006, est la source majeure de microplastiques dans les autres pays autorisant la pratique. A noter qu’en raison du long temps de dégradation du plastique, les parcelles suisses sont encore polluées par une pratique qui a cessé depuis près de 20 ans.
Actuellement, la fertilisation des sols se fait via compost et digestat (résidu du processus de méthanisation), et d’engrais minéraux. Or, en raison de plastiques jetés avec les déchets verts par les ménages et industries, tels que les sacs plastiques ou les étiquettes autocollantes sur les légumes et les emballages, une partie de ceux-ci demeure dans le compost et le digestat pour finir ensuite sur les sols.
Au total, entre 4 et 8 kg de plastique par hectare sont dispersés chaque année dans les sols via cette pratique. La quantité diffère selon le type de compost/digestat utilisé, car les procédés de fabrication, ainsi que l’origine des déchets verts sont des vecteurs d’influence. Les citoyens peuvent et doivent agir en triant correctement les déchets : pas de sac plastique dans les déchets, pas d’autocollant de labelling, etc. Aussi, une clarification de la part des industries doit être faite entre sac compostable et biodégradable. Alors que les premiers se dégradent dans le compost, les seconds ne doivent pas être jetés avec les déchets verts !
Enfin, des microplastiques se cachent dans l’enrobage des engrais et des semences. Les engrais à libération contrôlée utilisent ces microparticules afin d’enrober les nutriments et de contrôler leur relargage dans le sol. Ceux-ci sont très peu documentés en Suisse – et dans le reste du monde – , il est donc difficile d’estimer leur ampleur.
La pratique de l’enrobage des engrais et des semences est sur le point de changer, grâce à de nouvelles législations européennes sur les microplastiques qui entreront en vigueur d’ici quelques années. Celles-ci obligent notamment l’utilisation de polymères biodégradables. Alors que la Suisse applique les directives quant à l’obligation d’utiliser des polymères biodégradables pour les engrais, elle ne semble pas les suivre pour l’enrobage des semences. Il est pourtant important d’agir également sur ce point, en utilisant des alternatives biodégradables ! L’enrobage des semences, utilisé pour lutter contre les maladies, pourrait également être appliqué de manière plus ciblée. Des analyses d’échantillons menées entre 2011 et 2020 montrent que plus de 80 % des semis étaient sains et ne nécessitaient pas de traitement. Une approche plus holistique consisterait à appliquer l’enrobage uniquement aux semences dont un contrôle sanitaire confirme la nécessité du traitement.
Que faire pour lutter contre cette pollution ?
Ainsi, si l’on souhaite préserver la qualité des sols agricoles et leur fertilité, plusieurs points sont à retenir. Premièrement, il est nécessaire que chacun·e agisse en limitant la présence de plastique dans le compost : c’est une source involontaire de microplastique qui n’est pas visible ! Dans le même sens, éviter l’enrobage des semences lorsqu’il n’est pas nécessaire semble également être une piste cohérente. Ensuite, lorsque l’utilisation de plastique présente des bénéfices clairs pour les cultures, comme c’est le cas pour le maraîchage, celui-ci doit se faire de manière à limiter sa présence dans les sols. En ce sens, une clarification sur la biodégradabilité du plastique doit être faite, et communiquée de manière transparente par le marché. Au-delà des pratiques agricoles, ce raisonnement doit être fait de manière globale : éviter le plastique lorsque celui-ci n’est pas nécessaire, développer des alternatives lorsqu’il présente des avantages, et limiter sa pollution lorsque l’on ne peut s’en passer.

Article posté le 14 août 2025 par Océane Pfister, étudiante en Bachelor à l’Université de Lausanne, Suisse
Sources utilisées pour cet article :
Asare, P. (2023, 2 avril). Le contrôle sanitaire des semences céréalières permet de limiter le recours aux produits phytosanitaires. Agrarforschung Schweiz. Repéré à https://www.agrarforschungschweiz.ch/fr/2023/04/le-controle-sanitaire-des-semences-cerealieres-permet-de-limiter-le-recours-aux-produits-phytosanitaires/
Assessment of agricultural plastics and their sustainability : A call for action. (2021). (S.l.): FAO. https://doi.org/10.4060/cb7856en
de Souza Machado, A. A., Kloas, W., Zarfl, C., Hempel, S., & Rillig, M. C. (2018). Microplastics as an emerging threat to terrestrial ecosystems. Global Change Biology, 24(4), 1405‑1416. https://doi.org/10.1111/gcb.14020
Fertilizers Europe. (2020). Micro plastics. Fertilizers Europe. Repéré à https://www.fertilizerseurope.com/circular-economy/micro-plastics/
Jacques, O., & Prosser, R. S. (2021). A probabilistic risk assessment of microplastics in soil ecosystems. Science of The Total Environment, 757, 143987. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143987
Kalberer, A., & Kawecki-Wenger, D. (2019). Flux plastiques dans l’agriculture suisse et risques potentiels pour les sols.
Kalberer, A., Kawecki-Wenger, D., & Bucheli, T. (2019). Plastik in der Landwirtschaft : Stand des Wissens und Handlungsempfehlungen für die landwirtschaftliche Forschung, Praxis, Industrie und Behörden. (Rapport No. 89). Agroscope. Repéré à https://ira.agroscope.ch/en-US/publication/42595
Kawecki, D., Goldberg, L., & Nowack, B. (2021). Material flow analysis of plastic in organic waste in Switzerland. Soil Use and Management, 37(2), 277‑288. https://doi.org/10.1111/sum.12634
Nizzetto, L., Futter, M., & Langaas, S. (2016). Are Agricultural Soils Dumps for Microplastics of Urban Origin? Environmental Science & Technology, 50(20), 10777‑10779. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04140
OFEV. (2020). Les matières plastiques dans l’environnement : Matières plastiques dans les déchets verts. OFEV. Repéré à https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/politique-des-dechets-et-mesures/matieres-plastiques-environnement.html
Palazot, M., Froger, C., Kedzierski, M., & ADEME. (2023). Projet MICROSOF : Recherche de microplastiques dans 33 sols français. Repéré à https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/6572-projet-microsof-recherche-de-microplastiques-dans-33-sols-francais.html
Zhang, K., Hamidian, A. H., Tubić, A., Zhang, Y., Fang, J. K. H., Wu, C., & Lam, P. K. S. (2021). Understanding plastic degradation and microplastic formation in the environment : A review. Environmental Pollution, 274, 116554. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116554
24.3381 | Examiner des mesures pour réduire les enrobages de semences contenant des microplastiques | Objet | Le Parlement suisse. (n.d.). Repéré à https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243381
Ordonnances et réglementations :
European Union. (2023). Règlement (UE) 2023/… de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique.
Conseil fédéral suisse. (2005, 18 mai). Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Repéré à https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/fr
Conseil fédéral suisse. (2023, novembre). Ordonnance sur la mise en circulation des engrais. Repéré à https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/711/fr#fn-d7e4881






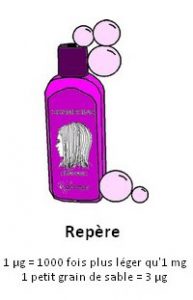 Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an
Il se vend près de 6 shampoings chaque seconde en France soit près de 200 millions de bouteilles par an Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes
Les produits d’entretien classiques contiennent des tensioactifs (appelés aussi agents de surface ou détergents) qui permettent d’éliminer les graisses et autres salissures à la surface de matériaux. Les détergents anioniques (charge négative) et amphotériques (dont la charge dépend du pH de l’eau) sont particulièrement présents dans les produits nettoyants, en raison de leurs propriétés nettoyantes et moussantes  Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde
Les phtalates, produits à quelque 6 millions de tonnes par an dans le monde  20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne
20 millions de lave-linge tournent en France chaque jour en moyenne  La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe
La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments : plus de 3000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement disponibles sur le marché français. Une fois que ces substances ont agi dans l’organisme, elles sont excrétées, essentiellement dans les selles et les urines, puis relarguées dans les réseaux d’eaux usées (médicaments humains) et dans les sols (médicaments vétérinaires). Une partie de ces résidus de médicaments se retrouvent donc d’une manière ou d’une autre dans le milieu aquatique. Des traces de ces composés sont d’ailleurs régulièrement détectées dans les eaux de surface et même dans les eaux de nappe 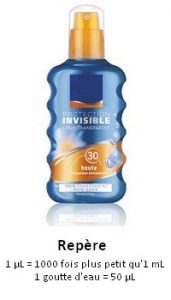 On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent
On estime que 4000 à 6000 tonnes d’écran total sont libérées chaque année dans les zones de récifs tropicales par les 78 millions de touristes qui s’y rendent  En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones
En raison de son faible coût, l’huile de palme est, depuis quelques années, très utilisée dans l’alimentation: elle est présente dans 1 produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en Europe (chips, biscuits, crème glacée, etc.). Or, la plantation de palmiers est à l’origine de déforestation, notamment en Indonésie. Dans ce pays, 3 millions d’hectares de forêt tropicale ont été détruits à cet effet entre 1990 et 2005 et le gouvernement prévoit un plan d’expansion des plantations de palmiers à huile de 14 millions d’hectares. La conversion des forêts en palmiers à huile a montré une perte de 80 à 100% des espèces de mammifères (dont l’orang-outan), reptiles et d’oiseaux dans ces zones 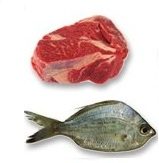 Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les animaux se nourrissent d’aliments (céréales, petits animaux, etc.) contenant différents polluants. Au fil du temps, ces derniers s’accumulent dans l’organisme de l’animal et en particulier dans les graisses (phénomène de bioaccumulation). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence de nombreux pesticides et de PCB dans du saumon et du steak haché achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne
Tout comme les fruits et légumes, le riz peut contenir différents polluants tels que des pesticides, en particulier s’il est issu d’une agriculture intensive classique (non « bio »). Ainsi, une étude de 2010 a révélé la présence d’isoprothiolane et de tricyclazole, 2 pesticides interdits d’usage en Europe, dans du riz acheté dans des supermarchés de la région parisienne 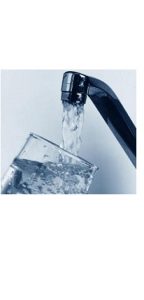 L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées
L’eau du robinet est globalement de bonne qualité en France et les normes en vigueur sont généralement respectées  Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne
Les fruits et légumes issus de l’agriculture intensive « classique » (c’est à dire non « bio ») contiennent des mélanges à faibles doses de substances chimiques classées, par les instances officielles, cancérogènes certaines, probables ou possibles ou soupçonnées d’être perturbatrices du système endocrinien. C’est ce qu’illustre notamment une étude de 2010 qui a révélé la présence de nombreux pesticides dans des produits achetés dans des supermarchés de la région parisienne  Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L)
Le lave-vaisselle est généralement moins consommateur en eau (12 L) que le lavage à la main qui dépend beaucoup du manipulateur (10 à 50 L) 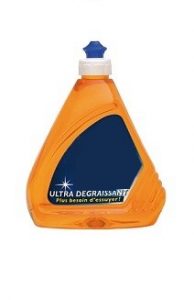 Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%
Le liquide vaisselle est un détergent composé d’agents nettoyants appelés tensioactifs, mais aussi de colorants, conservateurs et parfums de synthèse. Bien que les tensioactifs ont l’obligation d’être biodégradables à 90%  Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain
Les composés perfluorés (PFC), tels que le téflon, ont la propriété de repousser l’eau, les matières grasses et la poussière. Ils sont ainsi utilisés comme antiadhésif dans de nombreuses poêles et casseroles. Les PFC sont persistants et s’accumulent dans les êtres vivants: certaines études ont révélé la présence de certains PFC dans les cours d’eau et les poissons (dans le foie notamment) ainsi que dans le sang humain 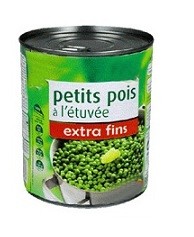 3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006
3,8 millions de tonnes de bisphénol A (BPA) ont été produits en 2006 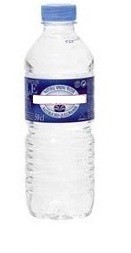 Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des
Ces bouteilles contiennent notamment des phtalates, produits chimiques utilisés en tant que plastifiants et qui font partie de la famille des